Ce récit est en partie inspiré de mon voyage de six mois en Thaïlande en 2009, et à la fois de mon imagination. Les faits ne sont pas tous véridiques, mais orchestrés de manière à donner une certaine ambiance. – Maender
C’était un après-midi carabiné de soleil sans un pouce de vent et du sable plein l’horizon. J’étais arrivé après eux sur Koh Wai et je flânais de solitude entre les roches de la plage, observant d’un œil d’iguane refroidit les touristes de la masse dorer leurs chairs molles sur la plage engluée. Il y avait dans l’air cette senteur propre au Siam et aux pays d’Asie, ce mélange de souffre, de décomposition et d’épices prenant à la gorge, plongeant l’esprit dans une marre d’effervescence où l’eau seule suffisait à nourrir la passion du moment. Les îles n’offrent pas de regard d’avenir, pas de passé ni de futur – chacune à son monde et chacun d’entre nous n’y a plus de passé. C’étaient des moments inoubliables parce qu’ils n’avaient jamais vraiment existé, puisque l’on semblait en perdre l’esprit dès le départ.
Eux, c’étaient eux : un couple de français qui ne pipaient mot d’anglais ou de thaï. Des vrais de vrai de l’aventure, des bronzés qui avaient pété un câble et s’étaient faits tatouer des anges et des démons sur les omoplates, les seins et les fesses, dans toutes les couleurs que les tiges en bambous voulaient bien apporter sous leur peau aussi dorée que l’aile d’un poulet rôti. Des vrais touristes aussi. Le cliché parfait. Le mec sans boulot, qui s’amusait à droite à gauche, prenait des vacances de six mois et baisait sa copine tous les soirs sans jamais se poser d’autre question. C’était un Henry Miller sans la passion des mots, sans les idées – le sexe est une des neuf raisons qui plaident en faveur de la réincarnation; les huit autres sont sans importance. Pattaya – il avait détesté. Pouvait pas supporter de voir ces gens venir évacuer leur frustration sur des putes bon marché. Mais il était forcé d’admettre que la Thaïlande avait ce don pour l’européen égaré, de faire tomber tous les murs de la bienséance et d’être un terrain de tous les possibles. J’avais déjà quitté le nord alors. Mon travail s’était achevé et je ne voyais aucune raison de repenser à ces moments envolés du passé où je donnais des cours insipides sur les fêtes des vendanges suisses à des asiatiques en uniforme blanc et noir qui se ressemblaient tous de part la couleur des yeux et la coupe de leurs cheveux de jais. Maintenant, quand j’y repense, alors que je bouffe mon brie de Saint Benoît derrière cet écran minuscule à poser ces mots bien à moi au lieu de travailler mes infatigables séries d’exercices, j’éprouve un certain plaisir à me remémorer ces regards et ces sourires subjugués d’admiration intempestive, et ces rires sans fin après des « Do you have a girlfriend? » pleins de lèvres et de joues empourprées, comme des morceaux de viande bien saignants qu’on aurait tendus pour se les faire voler. Parce que devenir un dieu n’est pas déplaisant, même si ce n’est un dieu que pour une classe de thaïlandaises mouillées, ce qui est déjà mieux que rien.
Cette expérience faite et racontée, ces Français tout de France m’ont fait place à leur table de souper. Je partageais alors mon voyage avec cette sublime allemande qui-m’aimait-bien-sans-plus-malheureusement. Hilarante, l’histoire ! Ils sont si subjugués par le fric des européens, la haut, dans ces régions moins touristiques ? Bah, oui, mon gars. Lui s’appelait Vincent. Sa compagne, c’était… Je n’en sais plus rien. Plus aucune idée ! Il faut dire qu’elle savait bien glousser pour pas grand-chose mais ne pouvait cacher qu’elle préférait une bonne partie de jambes en l’air sous la moustiquaire roide comme une vitre qu’une bonne baise de mots dans un alambic d’alcool. Je me rappelle bien de l’allemande qui captait dalle que dalle à part qu’on ne s’occupait pas d’elle, Vincent et moi. Mais enfin : trouver des bonnes bouilles plus accueillantes que les familles ou que les couples innocents me donnait le droit de l’ignorer un moment. Puis je me rappelle aussi cette Joy, cinquième du surnom, qui nous servait la boustifaille. Un vrai banquet ! Digne d’un Dionysos sans les vignes, si vous voulez. S’il y a bien une chose que la Thaïlande ne me fera plus jamais oublier, c’est combien le rhum dégueulasse se mélange avec le piment et le poivre. Nous étions donc là tous les trois, à nous raconter nos vies, sous le coucher de soleil qui brûlait l’horizon et la mer. Mes expériences de voyage au nord les intéressaient plus que tout.
— Je suis une plante rampante, leur dis-je. Un solitaire qui se ballade de droite à gauche au gré du soleil, du vent et des sourires. J’erre en Thaïlande du sud à la recherche d’âmes accueillantes prêtes à partager un repas, une boisson ou plus si affinité, du haut de mes dix huit années d’expérience dont je ne me rappelle pas le tiers. Je bouffe de tout, je touche à tout, je vis partout.
Je leur racontai comment j’avais rencontré l’allemande. Ils la regardaient et elle souriait. C’était à Koh Chang, pour tout vous dire. Je venais d’arriver du nord, trois cents francs en poche et pas moyen de faire recave, après avoir dit solennellement adieu à ma famille d’accueil (avec tout le tralala des mains jointes) ; et c’était pour la vie. Je ne savais pas où j’allais, à peine d’où je venais. J’avais réservé un bungalow avec télé et je m’apprêtais comme une andouille à passer ma première nuit à profiter des chaînes européennes.
— Décidé à aller manger un morceau, je prends mes clés et je fais toute la baie, leur dis-je. Personne nulle part; je n’ai appris que plus tard que j’avais choisi la moins touristique des plages ; comme quoi pour faire une entrée fracassante dans les bars du monde, c’était du réussi. Dans un restaurant, je tombe sur un groupe d’allemands. Il y en a un énorme qui coule sur sa chaise comme un gros vacherin glacé qu’on aurait laissé sous le soleil. Avec lui, une asperge, à l’air passé de date depuis quelques années. Et trois jeunes – dont cette fameuse blonde qui a réussi à m’amener à dos d’éléphant, mât bien dressé pendant toute la ballade. Une fois le repas fini, je fais ce que je n’ai jamais fait qu’en Thaïlande : j’aborde. En deutsch ! Dure la vie. Passage à l’anglais, je pige davantage. J’apprends que le gâteau sur sa chaise est à la retraite, que l’asperge périmée l’accompagne, que les deux autres s’appellent Marten et Dimitri et qu’ils sont en vacances pour une semaine. L’allemande, quant à elle, est hôtesse de l’air et est là par un concours de circonstances et par des réductions avantageuses. Toute seule ! On fait connaissance. Ensuite, adieu le gros, toute la bande, moi accepté, va boire un verre à la plage voisine. Quatre : un scooter. Tout baigne. Et je vous parle pas de l’escarpement des routes ! Bon, on a quand-même fait quelques allé-retours, je confesse. Quoique j’en ai déjà vu six – toute une famille, sur un seul, une fois ! On picole doucement, on discute. L’allemande à trois semaines devant elle; elle vient d’arriver et ne sait définitivement pas quoi faire de son temps. Je suis tout seul ? Pourquoi pas une ballade à dos d’éléphant le lendemain ? Et l’affaire est lancée.
Ah, ces français ! Des motards en plus. Des amoureux du camping car. Déboussolés, quelque part, de se retrouver à partager leurs toilettes avec tous les pensionnaires de l’île. Car c’est les pensionnaires qui surprennent, entre les lézards, les araignées géantes, les rats et tout l’incongru du reste sous les trente degrés. Koh Wai est minuscule, et on y dort pour rien, on y bouffe comme à l’olympe et on y boit comme chez les russes.
Puis vient qu’on s’envole : c’était l’anniversaire d’une tenancière – la fameuse Joy – qui avait vingt sept ans. Whisky pour tout le monde ! Toutes les tables furent conviées; je rencontrai plein de gens; Vincent se mit à boire comme un trou et finit sans doute mort quelque part. Moi je dansais avec Joy et l’allemande – encore des souvenirs qui m’apparaissent comme dans un rêve tellement j’avais l’impression d’être un autre. L’allemande partit se coucher – fatiguée, la pauvre –, le gay de frère de Joy me faisait chier parce que je frôlais sa sœur d’un peu trop près, puis s’endormit sur la table. Moi je passai à la vitesse supérieure. Je rivai mes lèvres à celles de Joy et elle me laissa fourrer ma langue dans sa bouche. C’était bien une des premières fois qu’un un truc pareil m’était arrivé sans avoir « trop » bu, alors j’en ai profité. Je passai mes mains sous sa robe une fois que nous nous fûmes écartés de la lumière et des derniers touristes pour se plonger dans l’ombre et la lune. Je lui demandai si elle voulait qu’on bouge dans son bungalow – hors de question pour elle. On pouvait pas aller dans le mien : il y avait l’allemande qui dormait ! Après quelques nouvelles embrassades – sa main contre ma braguette – Nous allâmes vers la plage la plus éloignée de l’île, où nous étions sûrs de ne trouver personne. Nous nous étions allongés sous les palmiers, et je censure tout ce qui a bien pu me fourguer je ne sais quel MST.
Lendemain matin. Une belle journée de plus. Il faut dire : sur cent septante jours, je n’en ai eu que trois de pluies. Le soleil était devenu une constante, une omniprésence. Le temps se perdait dans le rythme des jours – je finissais pas ne plus savoir quand j’avais fait ci ou ça, à ne plus faire de différence.
Il y avait deux êtres en moi : un qui dormait le jour, l’autre la nuit. Des bons vivants. Des inconnus pour celui que je suis devenu, devant ces écrans, ces formules et ce morceau de brie. Mon voyage m’a appris que la personnalité est autant volatile que l’uranium de Fukushima, tout cœur bien fondu. Certains vivent en lésés de leur présent, dans des villes trop grandes pour eux, dans des communautés trop rapides. D’autres prennent peur devant les immensités solitaires, et s’enfuient retrouver la chaleur de la fourmilière. Et dans le désert de l’homme où dans sa cité, encore, tout dépend : du mode de vie, des gens que l’on croise. Le fait de devenir est relatif, superflu : il n’y a pas de devenir, que de l’adaptation et la puissance qu’elle apporte. On naît ignorant et sans défaut, on meurt ignorant, bourré de déformations dues à la vie. Mais c’est ces déformations que l’on aime. En Thaïlande, j’étais devenu quelqu’un d’autre. Quelqu’un qui me faisait peur et que j’admire, maintenant, avec le recul. Une personne que je redeviendrais bien. Mais le retour en Suisse l’a cassé en deux comme la coquille d’un œuf.
Je me réveillai à côté de l’allemande, me rappelant vaguement y être arrivé. Faute d’avoir dormi sur la plage, et picolé encore. J’allai prendre une douche et une fois propre, je retrouvai ma compagne de voyage pour le déjeuner. Joy était là et me sourit en nous apportant notre soupe de riz. Je n’ai jamais rien mangé de ma vie qui soit autant capable de réveiller les tripes et l’esprit : une soupe de riz avec profusion de piments. Un véritable régal. L’allemande m’apprit qu’elle partait à Angkor. Elle avait discuté la veille avec un groupe de jeunes – minimum cinq ans plus vieux que moi – et s’était mise d’accord pour les accompagner au Cambodge. Faut dire : c’était ma faute. J’avais pas arrêté de lui rabâcher cette histoire de temples perdus et magnifiques, mélanges d’hindouisme et de bouddhisme, pendant la semaine que nous avions passé à Koh Mak. j’y étais allé juste avant de partir du nord. Mais, en fin de compte, même si j’acquiesçai vaguement, j’étais bien content de la voir poursuivre son chemin de son côté. De toutes les manières, ça devenait insoutenable de dormir à côté d’elle en caleçon, sous la moustiquaire, par cette chaleur épouvantable, sentir son parfum dans la nuit en n’avoir que le droit de la contempler dormir.
Du coup, je me décidai à foutre le camp aussi. Pas dans la même direction : je retournerai à Koh Chang. Au revoir Koh Wai : j’avais passé quelques jours sur cette île déjà et je ne voulais rien de plus que ce que j’avais eu. J’étais aussi effrayé quelque part – alors fallait que je foute le camp. J’ai un talent inné pour me désister de ce qui m’implique, un pouvoir incroyable pour ne prendre aucune responsabilité du sentiment. J’ai peur de ce que je ressens et je ne m’en plains pas : c’est ce qui me pousse à faire mon autocritique et à écrire. J’avais donc levé le camp à midi. L’île disparaissait, engloutie par les flots. J’avais pris un navire en compagnie de deux français.
Je n’ai jamais mangé de barracuda qu’avec eux je crois. C’était un véritable délice. Nous nous étions retrouvés à Koh Chang chez le tatoueur de Vincent pour un magnifique repas. Le type était bardé d’essais de diverses couleurs et maigre comme un clou. Sa femme était des plus accueillantes, et belle de surcroît. Ses gamins aussi – ils lui ressemblaient.
Une fois le poisson enfilé, j’allai traîner dans les bars. J’ai discuté avec des gens de passage, des amis d’un soir. Il y avait des vols long courrier, partis pour plusieurs mois. D’autres qui ne s’arrêtaient qu’aux quatre coins du globe pour une brève respiration. L’anglais fusait. C’était à cette période que j’avais perdu toute notion du temps. Je vivais sans heure, sans montre, sans téléphone. Je n’avais rien d’autre que quelques livres, mon sac à dos, trois chemises et deux shorts. Il m’arrivait souvent de boire doucement, en compagnie de thaïlandais et d’européens, sans distinction, faisant durer le plaisir d’être libre de toute contrainte, de tout devoir. Je me couchais à des heures pas possibles dont je n’avais aucune idée ; je me levais et j’allais manger un morceau, pour me perdre sur les plages à marcher, à dormir et à lire. Je me posais sur les hamacs des grands hôtels, ne commandais rien à boire, car je n’avais pas assez d’argent. On me chassait, parfois. Je continuais ma route pour me poser plus loin, ressortir mon livre, dormir encore. Rien derrière. Rien devant. Juste moi et les histoires. Ce fut le plus pur voyage que mon âme ait faite. La plus grande intoxication de mon corps. Un grand moment de solitude, même si je passais mes nuits à discuter avec des gens, avec ces deux français que je revoyais de temps à autre – Vincent me demandant où en étaient mes affaires. Lorsqu’on est à ce point solitaire, on finit par ne plus être une seule et même personne. On se dit d’un autre endroit à chaque inconnu. Rien n’est plus foisonnant que l’imagination qui naît alors. On devient tous les passés que l’on a rencontré. J’étais les belges avec qui j’avais fait un après-midi au bord de la piscine, les belles russes qui n’avaient pas voulu de moi. Chacun d’eux m’avait raconté son histoire, et j’étais devenu eux. J’étais libre de recracher les passés des autres en les prétendant miens.
Puis j’avais perdu le contact avec les français. J’étais parti comme un voleur, un beau matin. Sans leur dire adieu. J’avais pris mon sac à dos, mes livres et j’étais parti. Pour me faire de l’argent, j’avais vendu les bouquins achetés au nord pour trente baths à une librairie pour touristes, deux fois plus chers. J’ai pu me procurer du tabac à priser. J’en prenais quelques traits sur les pentes chaotiques de l’île. Sur le bac qui m’a amené sur le continent. Dans le bus à la climatisation foutue qui me portait avec des mômes braillant vers Bangkok. À côté du chauffeur de taxi, qui m’a fait rejoindre le centre des bus du nord, où j’ai attendu huit heures avec une bouteille d’eau et je-ne-sais-plus-quel-roman, que Freya arrive. C’était une autre allemande rencontrée au nord, lorsque je travaillais. Elle faisait également partie de l’association avec laquelle j’étais parti, et avait prévu de rencontrer d’autres membres au sud. Elle m’avait invitée, et je suis allé en sa compagnie à Koh Tao. À vingt quatre heures de voyage sur la route, au total, depuis Koh Chang.
Quelque part, les gens de mon âge me dérangeaient. Je n’avais jamais pu me résoudre à suivre ces jeunes, partis comme moi en Thaïlande pour un voyage culturel, et qui s’étaient tous mis d’accord pour un séjour dans le sud. J’avais la fibre plus rude du solitaire. Je ne supportais pas de savoir où j’allais le lendemain. Ce que j’allais faire. Avec qui j’allais discuter. La planification avait perdu tout sens.
J’avais tout de même passé trois jours avec eux, dont une « full moon party » engorgée d’alcools. Dans ces pays, on peut boire plus. On sue l’alcool avant même de l’avoir descendu. À cause de la chaleur. Aujourd’hui, aucun de ces jeunes ne me revient. Je ne les reconnaîtrais même plus. En revanche, je me souviens très bien de ces serveuses de Paris qui avaient loué un bungalow juste à côté du nôtre. Lorsque le groupe de l’association était parti, j’étais resté, prétextant ne plus avoir d’argent. Ce qui était vrai, en un sens. Je devais me racheter un téléphone – l’autre ayant pris un bain de mer dans la poche de mon maillot.
Koh Tao. Des beaux fonds marins. J’avais pris masque et tuba, m’étais aventuré entre les dômes de corail. On m’avait piqué mes lunettes de soleil pendant que j’étais dans l’eau. Je n’avais jamais rien vu de tel – chasser des poissons-hérissons à la fleure du couteau, rien que pour le plaisir de les voir devenir énormes ; nager après les bancs de toutes sortes dans le ballet multicolore des écailles ; s’avancer plus au large, se signaler à un navire ; croiser un gros spécimen venu de loin et qui nageait de travers ; reculer devant les requins pointes noires, le sang soudain glacé ; retourner sur la plage et s’allonger sur le sable, s’acheter un demi de bière au premier bar venu et finir la journée avachi dans l’eau.
Je n’ai pas fait grand-chose. Ce qui, en un sens, me faisait voyager davantage encore. En moi. J’avais fait table rase. Tout vidé. Je m’étais remémoré les cinq mois de mon séjour, consignés dans le journal que j’avais écrit, pour les lancer dans l’abîme. Tout y était passé – Ma mère d’accueil, Kon Kaen, Hong Kong, la Chine, Chiang Mai, les milliers de ballons enflammés du nouvel an, emportant les vœux d’autant, les cloques sur mes mains après avoir fait le tour de Koh Wai à la rame, la robe verte de cette fille qui m’avait raccompagné un soir à mon hôtel de Koh Chang et qui voulait un petit bonus de baths « with happy end », les temples d’Angkor, leurs beautés mêlées de la stupeur des âges, le fond marin brusquement visible sous les coques du catamaran lancé à pleine vitesse entre deux îles miniatures, les jeunes cambodgiennes qui vous couraient après en demandant de l’argent, parfois jusqu’en dix langues différentes, les embarcations-maisons sur le lac Tonlé Sap, et ses fermes à crocodiles, les souterrains de la guerre du Vietnam et mon pote Will du Canada, la communauté du Cameroun avec qui j’avais fait la fête en dissertant sur Dieu.
Au final, juste avant de rentrer à Bangkok en me rendant compte qu’il me restait juste de quoi payer le voyage de retour, il n’était rien resté de moi. Juste un jeune homme sans âge. L’esprit défait de lien. Le corps en paix. L’âme libérée.
Puis il y avait eu ces trois jours où j’avais regardé la télé, où j’avais bu de l’eau et mangé quelques soupes lyophilisées. Plus d’argent. Je m’étais acheté un nouveau téléphone à Bangkok, et m’étais réfugié dans le studio que ma famille d’accueil m’avait prêté. Trois jours derrière une page blanche. J’avais tout le temps d’écrire sur ce dernier voyage en solitaire. Impossible.
Ma conseillère, prétextant un séjour d’affaires à la capitale, était venue me rejoindre. Elle avait pris le soin de m’apporter mes dernières affaires – des trucs inutiles, que je n’avais pas eu le cœur de jeter quand j’étais encore au nord – et qu’elle avait dû reprendre avec elle, agrémentées de mes adieu à la famille d’accueil. J’ai récupéré ma valise à l’association.
Et j’ai pris l’avion. Je n’étais rien, je n’étais personne. Jusqu’aux quais de gare de Neuchâtel.
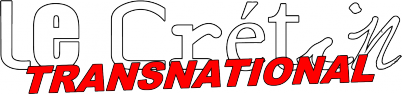



Comments by Mathieu Maender