Ce texte est un extrait du livre “Le Songe” publié en 2014.
– Maender
Un matin d’automne 1753, aux alentours de midi, lorsque le soleil berce la campagne d’une paresseuse chaleur, apparut sur le chemin poussiéreux qui menait à un petit village un garçon sale et maigre. Comme venu de nulle part, ce dernier demanda le chemin de la mer, et repartit du même pas claudiquant qui l’avait fait apparaître d’entre les arbres.
Lorsqu’on le retrouva, quelques heures de marche plus loin, il était couché sous un arbre et endormi par la fatigue. Il fut soigné par une famille, qui le prit en affection. Les habitants se souvinrent de ce petit corps que tous avaient vu passer en marchant, couché sur le dos d’un grand cheval brun, rejoindre la ferme des Bren, qui habitaient non loin.
On ne sut jamais d’où il était, ni pourquoi il tenait tant à voir la mer. Beaucoup soutinrent qu’il venait d’un orphelinat du pays, où les enfants abandonnés ne cessaient d’affluer. Les abandons se faisaient en nombre, et il n’était pas rare de croiser de jeunes gamins perdus. Mais aucun qui, avec autant de détermination, cherchait l’océan. Lorsqu’on lui demandait d’où il venait, le garçon répondait avoir entendu en rêve le chant des goélands, qui lui intimait de se rendre en mer, loin des tourments des hommes.
Il n’y avait que peu de bouches à nourrir chez les Bren : les parents vivaient en compagnie de leurs deux enfants, Édouard et Rose. Édouard était légèrement plus jeune que l’inconnu qu’il toisait de haut, se sentant fier, campé sur ses jambes de dix ans. Sa sœur, quoique plus jeune, réservait sa parole à de rares occasions quand elle jouait dans les champs de blé. Tous deux accueillirent le nouvel arrivant avec la lointaine sympathie qui liait l’innocence de la jeunesse. Monsieur Bren, qui possédait plus de dettes que d’argent, jugea malgré tout bon d’avoir une paire de bras en plus afin de travailler ses champs. De plus, le jeune arrivant ne devait pas être trop difficile : la vie qu’il lui offrait valait bien celle des orphelinats.
Le gamin fut sur pieds en quelques jours, et travailla pendant deux semaines avec le fils Bren, qui le traitait, bien qu’il restât un inconnu, comme son égal. Le père en décida autrement, nourrissant à peine l’orphelin. Monsieur Bren voyait celui-ci comme une sorte de cadeau de la providence qui lui permettrait à bon prix de remettre son économie à flot.
Personne ne vit les symptômes arriver. Le garçon – qui s’était toujours refusé de donner son nom – tomba malade. On n’appela aucun médecin, on ne prit aucune mesure, laissant le pauvre enfant sur son lit de paille au fond de l’étable, parmi les bêtes. Lorsqu’il mourut une semaine plus tard, il fut enterré dans une fosse commune comme s’il n’avait été qu’un banal déshérité crevant la faim et retrouvé mort sous un arbre, près du chemin qui menait à l’océan.
Lorsque par le premier matin de l’hiver, sa fille tomba malade, Monsieur Bren crut à un châtiment céleste et s’empressa de dépêcher le médecin, payant le prix fort. Ce dernier ne vint que quelques jours plus tard, ruinant la famille endettée. Son verdict fut bref, et Bren n’y comprit rien : qu’était cette fièvre des bateaux, ce typhus, qui se faisait porter par les poux ? Une fois que fut parti le médecin, qui n’avait – au vu de l’argent que proposait la famille – donné que des conseils, Monsieur Bren alla longuement embrasser sa fille, vociférant dans ses pleurs du coup du sort qui s’abattait sur lui. Il se souvenait vaguement avoir entendu quelques rumeurs sur cette maladie, qui se développait avec la proximité et était très virulente ; mais il ignorait totalement ce que virulente pouvait signifier.
Aussi fut-il surpris lorsque, quelques jours plus tard, il se retrouva cloué au lit, une vilaine fièvre le vidant de sa substance. Sa femme ne tarda pas à tomber malade elle aussi. Incapables de s’occuper de leurs terres, les Bren ne se reposaient plus que sur leur fils, qui les maintint en vie avec le peu de ressources que la ferme possédait.
La sœur d’Édouard mourut en premier, puis ce fut au tour de la mère, et enfin du père. Sensibilité à la maladie, mauvaise nutrition, ou vengeance divine ? Personne ne le sut jamais, mais Édouard se rangea sur la dernière possibilité.
Le fils Bren se retrouva seul, incapable de s’occuper de la ferme, endetté jusqu’à l’os ; seul, avec cette étrange parole d’un garçon qui avait traversé le village en quête du rivage :
« Je veux trouver l’océan pour entendre le secret des goélands ».
♠
Quelques jours plus tard, au chantier naval de la Compagnie Maritime, à L’Orient, qui ne cessait de s’agrandir, un petit garçon arriva, marchant seul dans le matin couvert de sa première couche de givre, par le chemin qui longeait le fleuve.
Il s’arrêta à une maison basse, séparée de la ville par quelques champs, et couverte de grosses tuiles d’un rouge étrangement foncé, qu’il compara à du sang séché. Une jeune femme lui ouvrit, les yeux en amande, le sourire aux lèvres.
Édouard vécut avec sa cousine Émilie et son mari durant cinq ans, allant de petit travail en petit travail au chantier florissant. Il contemplait avec des yeux d’adolescent remplis d’envie les fiers navires qui étaient mis à l’eau, écoutait chaque soir le cri des oiseaux marins avant de s’endormir.
À quatorze ans, il embarqua pour la première fois sur une petite coque de noix munie d’une voile amovible, et pêcha dans la rade avec un vieil homme sans famille. Il finit par devenir un poids trop important pour sa cousine et son mari, loua une chambre à une des pensions de la ville, et reprit l’embarcation de pêche du vieux monsieur.
Lorsqu’il était sur l’eau, posant filets et cageots, il ne pouvait s’empêcher de regarder au loin les énormes bâtiments de guerre et de commerce s’évanouir sous la courbe de l’horizon, éternellement attiré par la liberté qu’il croyait discerner parmi les immensités qui se cachaient loin de la pestilence des hommes, loin de leurs maladies, de leur méchanceté.
Ses opinions changèrent progressivement. Il courtisa une jeune fille, à laquelle il promit bien des trésors et des richesses. De temps à autre, il rendait visite à Émilie et à son mari, avant d’aller se perdre dans la tranquillité de la forêt voisine.
Un beau jour vint où il fut assez aguerri pour entrer au service du Roi. Il vendit son embarcation de pêche, et s’engagea à bord d’une frégate de la marine. Pour l’avoir vue en construction, il en connaissait les moindres détails. Oubliant son passé, sa cousine, Édouard prit le large, laissant derrière-lui une demoiselle le cœur plein de promesses, et le chant des goélands qui l’avait guidé jusqu’aux ailes des navires.
Édouard Bren ne navigua que très peu de temps comme simple matelot ; il obtint assez rapidement de l’avancement, de timonier jusqu’à officier de quart, d’officier de quart à maître d’équipage, puis à maître de manœuvre, et enfin, devint second. Sa carrière ne fut pas sans rebondissements, du triste événement qui lui valut son surnom à bien d’autres rencontres.
Il se fit des amis sur les mers, laissant dépérir ses promesses et son avenir au port. Lorsqu’il était au loin, près d’elle ne savait quel continent, la jeune fille devenue femme à laquelle il avait ouvert son cœur regardait l’horizon, pleurant en silence. Il ne revenait au port que pour repartir, demandant avec zèle à prendre part à toutes les expéditions. Elle finit par l’oublier, lui et ses promesses, lui et son océan damné, dont elle quitta la rive et remonta jusqu’à la capitale.
La carrière maritime d’Édouard dura dix ans.
En mai de sa dixième année de service, alors que l’Atlas, la plus rapide frégate qui ne fut jamais construite à L’Orient à des fins militaires, approvisionnait l’un des ports français sénégalais, Édouard Bren accompagna le capitaine à l’intérieur des terres, se rendant au comptoir de la Compagnie pour des questions administratives. Il y découvrit un fort rudimentaire, entièrement construit en bois et en toile, et eut son premier contact avec l’esclavagisme de son époque. Lui qui avait vu son père maltraiter un orphelin, et mourir quelques semaines plus tard comme sous les éclairs de la vengeance divine, ne pouvait supporter la vision de ces enfants, de ces femmes et de ces hommes traités en main d’œuvre sans valeur.
Il resta trois jours aux alentours du fort, laissant le capitaine s’occuper des questions administratives, marchant à l’aveugle parmi les tentes, s’aventurant parfois dans les environs à la recherche d’un peu de solitude insouciante. Il ne connaissait rien de la faune locale, des grands lézards aux dents acérées cachés dans les eaux marécageuses, des serpents invisibles parmi les herbes.
Alors qu’il écrivait – ce que sa tante lui avait sagement appris –, assis dans l’herbe haute aux abords d’un étang à la couleur de bronze liquide, sa tunique de marin se mariant avec l’herbe jaunie par le soleil de plomb qui perçait un ciel constamment délavé, il crut entendre un bruissement inhabituel. Se redressant, il découvrit avec étonnement un homme noir, à une douzaine de mètres, lui présenter la tête d’un grand serpent qui gisait à ses pieds.
Très vite, Édouard se lia d’amitié avec l’homme. Il lui offrit même son béret gris, dont il ne se séparait plus depuis qu’il l’avait hérité du vieux pêcheur. Mais le sénégalais refusa tout présent en récompense de sa bonne action.
Lorsque, quelques jours plus tard, il découvrit deux jeunes esclaves à bord de l’Atlas, rapportées par le capitaine comme souvenir et passe-temps pour le voyage du retour, il entra dans une colère insoutenable. L’affaire qui suivit, ruinant sa carrière, resterait à jamais confuse.
Quand la frégate mouilla dans la baie de Port Louis, il ne fut plus jamais le même homme. Transformé, atterré, il ne révéla à sa cousine que quelques bribes de ce qui le conduisit, quelques années plus tard, à suivre un de ses anciens amis. Il avoua avoir fait la moitié du voyage de retour au fer, comme s’il n’avait été qu’un vulgaire prisonnier.
Terrassé, délaissé de tous sauf d’Émilie, il vécut alors comme un parasite de la nuit, ne sortant que rarement pour pêcher avec la vieille barque qu’il avait récupérée. Il refusait d’oublier ce qui lui faisait le plus mal, de le noyer dans le vin, respectant son serment et son surnom.
Lorsqu’un marin qui le prit en pitié pour avoir été sous ses ordres lui proposa de devenir maître de quart à bord d’un brigantin tout récent, il accepta sans même demander de détails. L’Aurore appareilla sans qu’il sache s’être engagé à bord d’un négrier.
Lorsqu’il revint, sauvé par miracle du naufrage, il était encore plus replié sur lui-même. Sa cousine ayant entre temps perdu son mari lui ouvrit sa porte, acceptant le lourd silence qui le suivait toujours. Seuls les légendes et les cris des goélands l’importaient. Souvent, il racontait que le capitaine du brigantin venait le hanter jusque dans ses rêves. Il ne tarda pas à repartir en mer, à bord d’un navire de nouvelle classe acheté par un autre capitaine, qui le nomma maître de quart.
Il finit par disparaître mystérieusement en mer, lors d’une nuit couverte de brume. Avait-il rejoint les légendes dont il s’était nourries toute sa vie ? Jamais il n’avait cessé de rechercher la liberté, l’oubli et le calme intérieur offerts par l’océan. Jamais il n’avait arrêté d’écouter les cris des goélands, dont un orphelin lui avait transmis la fiévreuse compréhension.
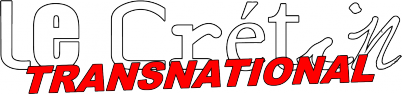



Comments by Mathieu Maender