Cher Monsieur d’Arlengesque,
Ci-joint un récit sur lequel j’aimerais bien que vous posiez vos yeux en qualité de Maître du Secret dévoué.
♣
Je l’ai connu au marché.
A l’heure où se déversaient dans les rues quantités de badauds, de flâneurs et d’amoureux pour une balade du dimanche, régnait sur la ville la chaleur étrange d’une journée de printemps qui s’annonçait balayée par les vents. Les vendeurs, entassés sur la place du marché autour de l’unique fontaine, tentaient tant bien que mal de protéger leurs marchandises des assauts de la brise marine avec de grands paravents qui faisaient ressembler les couloirs entre les stands à des pans de labyrinthe. Le ciel était d’un bleu profond, parcouru par des nuages passant tels des oiseaux vers l’intérieur des terres. Le soleil était haut et faisait ruisseler ses rayons sur les grandes vitres de l’hôtel de ville qui limitait le nord de la place.
Je tenais un petit stand de fleurs, coincé entre une exhibition de souffleurs de verre et de marchands de babioles en tout genre, participant à l’élaboration de la joie du lieu en apportant dans la mixture quelques touches de parfums et de couleurs. Les roses m’arrivaient tous les matins depuis un petit village de campagne, dont la délégation desservait la cité des fruits de ses champs.
Comme toujours lorsqu’avoisinaient les onze heures, la place se remplissait de mère de famille en quête d’approvisionnements et d’hommes venant faire réparer leurs outils auprès des forgerons et armuriers. Le calme du matin, où les couples se traînaient doucement, était alors submergé par l’écrasante population des docks et du quartier ouest.
C’est à ce moment là, au milieu de l’agitation grandissante, qu’il vint à moi pour la première fois. Affairée, je n’avais pas fait attention à son regard jeté à la dérobée depuis l’angle d’une ruelle, et ce ne fut qu’après que je remarquai qu’il m’avait observée pendant plusieurs minutes avant d’approcher du stand.
— Vous désirez ? Dis-je, sans relever la tête du bouquet que j’étais en train d’assembler.
—Une rose. Saignante.
—Elles souffriront toutes pour vous si vous le voulez.
Je lui tendis l’une des roses fraîches desquelles j’avais l’habitude de m’entourer pour masquer les effluves des étalages de poissons, qui montaient parfois depuis la partie sud du marché où ils s’entassaient tous. J’éprouvais un certain réconfort dans cette illusion de nature, submergée par le brouhaha et le mouvement incessant de la cité.
Il paya, prit la rose et s’en alla sans un mot, après m’avoir contemplée quelques secondes, son regard frôlant dangereusement le décolleté que je portais. Je repris mon travail et vendis à une jeune fille un grand assortiment de jonquilles. Une fois l’argent encaissé, je le vis à nouveau. Il s’était arrêté et me détaillait. Je remarquai pour la première fois l’uniforme qu’il portait : celui du Conseil. Je baissai les yeux, ne sachant trop où me mettre, comprenant d’un seul coup de quel genre d’homme il s’agissait, et pourquoi son regard se posait sans retenue sur moi. Je devais visiblement lui plaire. Je l’imaginais dangereux, aimant amener dans son lit les plus belles et les plus jeunes filles de la ville pour les jeter ensuite en échange de quelques aides financières, comme le disaient les rumeurs qui couraient dans les bas-fonds de la cité, où le Conseil, gérant la ville, n’avait pas vraiment la cote en popularité.
Je me trompais.
Ces mots que vous saisissez ici, dans cette enveloppe scellée, forment une courte histoire qui est la sienne, pas la mienne. J’y révèle des choses inavouables que personne d’autre que vous ne doit savoir de mon vivant, mais que je ne peux paradoxalement pas garder en mon cœur, poids trop lourd à porter. Je me trompais sur lui. Je me trompais sur toute la ligne, en ce misérable matin de beau temps qui était alors pour moi l’une des plus belles journées, mais qui s’avéra, en comparaison avec ce que j’allais vivre, rien de moins qu’une vulgaire matinée dans le cercle du marché, dans de l’illusion de sympathie des gens et le peu de nature que mes fleurs m’apportaient, déjà polluées par les effluves rances qui caractérisent toujours une ville portuaire.
Lorsque je redressai la tête pour voir s’il était parti, je ne vis personne à l’angle de la ruelle. Soulagée, je me remis à la tâche. Midi approchait et la foule commençait à désenfler. Dès l’après-midi, alors que je me reposais de ma matinée par une petite balade en forêt, sa présence avait quitté mon esprit.
Mais le lendemain, alors que la tête encore remplie de rêves embrumés je me dirigeais vers mon petit stand, je sentis mon sang se glacer et mon cœur se mettre à battre si vite qu’il semblait vouloir éclater.
Il était là, à m’attendre, à l’angle de la même ruelle. Peu rassurée, j’installai mon semblant de nature et de couleur sous son œil scrutateur, ne sachant que faire d’autre qu’attendre. Lorsque je terminai de mettre de l’ordre dans ma présentation, il s’approcha du même pas nonchalant que vous lui connaissez, cher Monsieur, et me commanda une rose rouge, exactement comme la première fois. Il n’y avait presque personne dans les rues à cette heure-ci, et je bredouillai une réponse en jetant des regards affolés dans toutes les directions à la recherche d’une quelconque aide. À mon grand soulagement, il partit, me laissant dans la main quelques pièces et dans la mémoire le souvenir de son sourire enjôleur. Il avait déjà disparu dans les petites ruelles du quartier lorsque je découvris que la somme qu’il venait de me laisser était par trois fois supérieure à ce que je lui demandais.
Mes premiers soupçons semblaient s’être confirmés, aussi ne fus-je pas surprise de le voir le jour d’après à m’attendre exactement comme la fois précédente. Quelque chose avait changé dans son regard. Il était à la fois plus déterminé et plus lumineux, et je me recroquevillai derrière mon comptoir lorsqu’il s’approcha de moi. Il me commanda une nouvelle rose rouge, sanglante, comme il disait, et je lui en tendis une sans un mot, les mains hésitantes. Il m’attrapa le bras avec délicatesse et fermeté, le sourire planté sur les lèvres.
— Je sais que ma présence vous importune, que vous avez reconnu mon uniforme, et quelles idées vous vous faîtes de moi, enchaîna-t-il en un seul souffle, confirmant mes pires craintes.
Je ne savais que faire. Son rang faisait de lui une personne infiniment plus respectable que moi, et qui sur un claquement de doigt pouvait envoyer le quart de la ville croupir dans des cachots pendant trois mois. Et s’il décidait d’affamer tous ces gens, personne ne lèverait le petit doigt pour les aider. J’étais paralysée. Il reprit :
— Mais comme rien n’est plus précieux que le temps, il n’est pas de plus grande générosité que de l’offrir.
Il me dévisagea longuement. La pression de sa main sur mon bras s’était relâchée ; je la sentais à peine. Voyant qu’il me dérangeait, il me lâcha.
— On ne vit malheureusement que pour quelques rencontres éparses qu’il ne faut en aucun cas manquer, continua-t-il en murmurant presque.
Il hésita quelques instants, et je compris son intention.
— Je ne suis pas comme on a pu vous le raconter, dit-il. Je ne suis pas comme vous croyez que je suis ; je suis sans doute pis, parce que bercé par un vice qui se dresse comme un rempart : ma timidité. Me feriez-vous l’honneur d’un déjeuner en ma compagnie ? Je vous offre un repas mémorable en échange d’un peu de votre temps. Comprenez bien que je suis un homme las des caprices des hautes sphères, mais n’en reste pas moins imprégné de noblesse. Si vous ne désirez plus me revoir ensuite, je ne viendrais plus vous importuner.
Inutile de souligner, cher Monsieur, que je n’ai pas su résister à ses paroles et à son regard suppliant, pas plus qu’à la simple perspective d’un repas de luxe. L’idée que je puisse avoir pitié d’un des membres du Conseil et de sa naïveté qui paraissait des plus sincères, m’attirait au plus haut point.
♣
Vous m’avez dit le midi de ce jour même, cher Monsieur, que si une ravissante femme comme moi sentait le besoin de se confier, vous étiez là, prêt à garder tous les secrets, et que vous me preniez sous votre aile en la qualité de votre profession. Je n’ai su que vous disiez la vérité que plus tard, lorsque ce jeune homme incertain que j’accompagnais et qui était paré des plus grands pouvoirs m’informa de votre position de Maître du Secret et de votre serment d’honneur. C’est pour cette raison que je vous envoie cette lettre, car je sais que, quoi qu’il arrive, vous vous tairez comme vous avez promis de le faire. Vous rappelez-vous avec détail cet endroit dans lequel vous preniez le petit-déjeuner en compagnie de votre femme, alors que nous nous étions assis à quelques tables pour notre déjeuner ? Oui, sans doute. Sans doute, puisque, dans la paraisse qui sied aux gens de votre rang, vous en étiez votre premier repas de la journée et que depuis ce jour, chaque midi, vous vous asseyez là dans l’attente de me voir arriver.
— Julien ! Aviez-vous tonné ce jour même alors que nous venions d’entrer, lui devant moi derrière, le regard perdu dans tout ce luxe qui me donnait l’envie de vomir. Quelle plaisir de vous voir, et en si charmante compagnie !
Monsieur, vous lorgniez sur moi un regard aussi lisible que ces mots, et la page semblait être posée quelque part entre mes seins. Pas que cela ne m’ait dérangée, au contraire. Il est normal de rendre hommage aux attributs d’une belle personne en la dégustant du regard, n’est-ce pas? Est-ce vous, ou un de ces pervers qui courent les rues que je viens de citer? Peut-être les deux.
Julien avait été surpris, presque terrorisé de vous voir dans ce restaurant. Sans doute avait-il eu peur que vous lui cassiez les maigres effets dont il se parait pour essayer de me séduire. Il ne se laissa pas démonter.
— Damien d’Arlengesque, quelle surprise de vous voir ici, commença-t-il. Cette jeune femme et moi venions prendre un repas en toute tranquillité, et nous avons déjà réservé notre table.
Vous aviez reporté sur moi votre regard, remarquant pour la première fois ma robe usée et où vous avez dû trouver quelques taches de vos yeux scrutateurs bien qu’elle fût propre, tant vous sembliez réticent à me serrer la main. Peut-être pour vous étais-je plus proche d’un petit four issu d’une mauvaise boulangerie que d’une véritable personne. Julien me présenta :
— Mademoiselle…
— Bonnaguia, Louise, achevai-je.
Nous nous serrâmes la main. Je suivais Julien jusqu’à notre table.
Durant le repas, il fit des efforts désespérés pour engager un semblant de conversation. Votre vue m’avait coupé une bonne partie de l’appétit que le dégoût de ce lieu si propre qu’il paraissait aseptisé m’avait laissé. Je mangeais un peu du délicieux gratin que l’on nous avait servi, sans toucher à la viande. À vrai dire, la sincérité de Julien et le mal qu’il se donnait ne me laissaient pas indifférente. Il avait les yeux verts, était plutôt sympathique à la vue sans être tape-à-l’œil. Il portait l’uniforme du Conseil avec modestie, ne l’exhibant pas comme vous exhibiez votre tenue de Maître du Secret.
Au dessert, le délicieux vin m’avait quelque peu délié la langue et je lui lâchais quelques clichés de mon existence de modeste marchande de fleurs sans grand revenu, alors qu’il écoutait lentement en jetant vers votre table des regards effrayés, espérant de tout son être que vous ne m’interrompiez pas pour prendre le café. Chose que vous fîtes, bien évidemment. Vous n’alliez pas laisser une fille de basse classe comme moi lui remplir la tête d’âneries, tout de même? Nous bûmes le café tous ensembles, dans un silence tendu que vous étiez le seul à ne pas ressentir. Même votre femme semblait lire sur les traits de Julien le malaise que vos paroles laissaient.
Lorsqu’après mains efforts ce dernier nous libéra lui et moi de vos griffes, il ne devait pas être loin des trois heures. Dehors, Julien m’invita à dîner le soir même. Chose que j’acceptai sans plus de cérémonie : sa sincérité et son rang avaient suffis à me convaincre et à dissoudre le reste de méfiance que je nourrissais à son égard.
♣
Il m’attendait devant ma misérable pension en complet à nœud papillon, debout à côté d’un attelage de luxe qui faisait penser à un carrosse divin. J’avais mis ma plus belle robe, mais rien ne m’empêcha de me sentir d’un seul coup sale et mal habillée. Son attitude était quelque peu changée : il semblait plus sûr de lui. Sans doute que sa réussite de l’après-midi avait grandi son assurance. Le cocher nous ouvrit la porte, et nous nous assîmes dans des sièges de cuir rembourrés qui faisaient ressembler la diligence à une chambre à coucher. Nous ne dîmes pas un mot pendant tout le trajet. Mais le silence que nous partagions était étonnement détendu. Il semblait à l’aise, et je l’étais presque, quelques peu angoissée notre destination et par ma tenue de modeste personne.
Lorsque la porte s’ouvrit, j’étais prête à subir tous les regards et tous les déshonneurs que l’on peut bien laisser pour lot à une personne de la basse ville. Je fus surprise de voir que nous étions devant un petit restaurant presque vide, qui donnait sur les grandes falaises bordant la baie au nord et se jetant dans la mer. Ce fut un véritable souper en tête à tête, à la lueur des bougies et aux bons soins du personnel, sous et le rayonnement d’une magnifique lune, bercés que nous étions par le ressac.
Je me laissai questionner à propos de mon travail, répondant par de courtes phrases. Il m’apparaissait clairement que ses questions n’étaient que pure courtoisie ; comment aurait-il pu s’intéresser à ce qu’une malheureuse vendeuse de fleurs pouvait vivre? Lorsqu’il eut épuisé toutes ses interrogations, il renversa de lui-même la vapeur et se mit à me parler insouciamment des problèmes du jour, et qui requéraient son attention en tant que membre du Conseil, dont il tenait la place de lègue paternel. Il était plus vieux que ce qu’il paraissait, ayant la trentaine.
Le repas fut excellent, et le vin enivrant. Jamais de ma vie je n’avais mangé de la sorte, jamais je n’avais dégusté soupe de topinambour, caviar, puis canard au citron où se mêlait un lointain goût de châtaigne, en buvant une bouteille datant d’avant ma naissance et qui, en d’autres circonstances, m’aurait permis de vivre deux ans sans travail.
Aussi ne serez-vous pas surpris, Monsieur, de savoir que je lâchai le peu de retenue que je possédais encore dès la fin du dessert – qui, d’ailleurs, consistait à un baba-au-rhum aidant passablement à mon humeur générale – Et me laissai me faire embrasser dès notre retour dans la diligence. Celle-ci nous amena tout droit dans la plus grande maison que je vis de ma vie, donnant sur une petite plage privée non loin du phare de la pointe et entourée de grandes allées de cyprès la séparant de magnifiques vignobles.
♣
La suite de cette épopée rocambolesque à laquelle j’avais de la peine à croire tellement elle était irréelle et impossible, vous la connaissez en partie, et vous pouvez aisément, avec votre machine à vapeur d’imagination tronquée, compléter les lacunes que possède votre version.
Trois jours s’écoulèrent durant lesquelles je fus aux petits soins de Julien, et où il fut aux miens, dans l’énorme maison que lui avait légué son père mort quelques années plus tôt, avec toute la ribambelle de domestiques qui à eux seuls auraient pu empêcher la prise de n’importe quel fort en submergeant les assaillants sous le nombre.
Julien fit venir le meilleur tailleur de la ville et lui demanda un assortiment de robes que mon ancienne armoire n’aurait jamais pu contenir, m’offrit des bijoux et des trésors dont je ne soupçonnais même pas l’existence, et m’emmena dans les soirées de la haute société auxquelles il se rendait plus pour afficher la présence d’un des membres du Conseil que par réelle sympathie pour les hôtes qui, dans la majorité des cas, cachaient derrière leurs belles manières une superficialité aussi hermétique que votre serment du secret.
J’appris vite à refouler le dégoût que m’inspirait toute cette farandole de politesses, de mets succulents et de parures hors de prix, pour jouer mon rôle et devenir plus aristocrate que bien des aristocrates. Julien me présentait comme étant issue d’une lointaine cité où j’avais le sang de noblesse que mes nouvelles manières semblaient transpirer, et j’acceptais tous ses mensonges sans ciller, tant il me paraissait, depuis ses grands tours et l’amour qu’il me vouait, innocent, naïf et perdu dans ce monde d’exhibition pathologique.
Le temps s’écoulait doucement. Une, deux semaines passèrent durant lesquelles nous nous entendîmes à merveille, dans les réceptions comme dans nos moments intimes. Je dormais bien à ses côtés, sans cesse caressée et cajolée comme si j’étais une poupée sur laquelle aucune poussière ne devait jamais se poser.
Mais l’idylle, n’est-ce pas, n’est qu’un mensonge ordurier qui ne sert que ceux qui n’ont jamais aimé. On dit que chaque amour est unique, mais c’est faux. Seul le premier compte, il est le seul qui soit violent comme la foudre. Les suivants sont toujours artificiels, voulus, et se déchirent dans la souffrance du déshonneur plus que dans celle de l’affection, car un cœur brisé ne peut l’être qu’une fois, et que, lorsqu’il l’est, on peut tout au plus laisser sur la surface de ses éclats quelques rayes.
Je fis tout pour faire de Julien un homme heureux. Je disais ce qu’il voulait entendre ; je faisais ce qu’il voulait que je fasse – j’étais la femme dont tout homme rêve, docile et affectueuse. Il me laissait découvrir son monde de pouvoir, doucement, moi, la petite marchande de fleurs entre le stand des souffleurs de verre et celui des amulettes.
Il m’expliqua qu’être membre du Conseil n’était pas une mince affaire, qu’elle impliquait d’être présent aux réunions des hautes sphères et dans la majorité des réceptions, de prendre des décisions au nom de l’opinion générale pour ne pas perdre l’appui des riches familles. Le conseil possédait trois membres délégués de la capitale, dont le gouverneur, et qui avaient la charge d’appliquer les volontés royales.
Il me fit rencontrer ses collègues, les six qui occupaient comme lui les rangs de conseillés de la ville. J’appris que tous sans exception avaient acquis leur pouvoir par lègues ou achats, et s’il y a une chose que cette bande de sages sans sagesse et avec beaucoup de politesse m’ont bien fait comprendre, c’est que l’intelligence n’accompagne pas toujours la fortune, et que des imbéciles triomphent souvent sur les cendres des grands hommes, apprenant juste ce qu’il faut pour se maintenir au pouvoir et jouer de leurs privilèges.
Puis ce matin noir arriva, ce matin où vous et moi connurent, comme la ville, comme le Conseil, l’effroi le plus total.
♣
Couché devant une bouche dégoût, le sang coulant encore dans l’eau croupie, le vieux gouverneur membre du Conseil était mort, assassiné, dans l’enceinte du palais dont seuls les sept membres possédaient un exemplaire de la clef.
L’arrestation, pour l’avoir vue de mes yeux, ne prit pas plus de cinq minutes.
Julien et moi étions nus, couchés dans le grand lit nuptial de feu Monsieur d’Aremor. Les rayons du matin perçaient depuis la porte-fenêtre de la terrasse et renvoyaient sur nos deux corps entrelacés la couleur pourpre des tentures.
Ils massacrèrent la porte d’entrée avec un bélier, et débarquèrent à trente devant notre lit. Trente gardes, envoyés par les cinq autres conseillés encore vivants.
Offusqué, Julien tempêta à s’arracher les poumons. Jamais, pour rien au monde, il ne laisserait des gardes emporter la femme qu’il aimait, sa Louise, disait-il. Jamais.
Mais les gardes ne venaient pas pour moi. Devant leur caractère hostile qui ne cillait pas, son sang se glaça, et il tomba dans un état proche de l’apoplexie.
— Qu’est-ce que signifie…
Je me rappelle encore la réponse du capitaine du détachement. Limpide, glaçante, concrète. Elle me figea jusqu’au plus profond de mon être.
— Hier soir, le gouverneur d’Allambard a été assassiné dans le palais du Conseil. Et c’est votre clef qu’on a retrouvée dans la serrure de la grande porte.
♣
Qu’avait donc fait Julien d’Aremor ? Cette question traversa tous les esprits, surtout le mien, durant les semaines qui suivirent. Julien avait donné quelques consignes aux domestiques, et ces derniers prenaient soin de moi, alors que lui croupissait dans les cachots de la ville en attente de jugement.
Qu’avait donc fait Julien ? Question à jamais sans réponse ? Le pensant innocent, je pris la décision d’agir, et d’essayer de le faire libérer. Je me souviens encore de la petite discussion que nous avons eue, vous et moi. Je portais une robe au décolleté plongeant qui semblait grandement vous plaire, choisie expressément pour l’occasion, et je me complaisais dans ce rôle de femme aimante délaissée et en proie au chagrin.
— Il m’a tout donné. Je dois le voir. Je vous en supplie, Monsieur d’Arlengesque, je vous en supplie, faîtes jouer vos relations pour que je puisse le voir, une dernière fois, avant l’heure du jugement !
Lorgnant sur moi vos deux pupilles dilatées, vous avez laissé échapper un « oui, oui… » un peu trop saliveux. Ayant obtenu votre accord, je vous avais quitté, le sourire aux lèvres, vous et vos fantasmes de primate.
Le soir même et par l’entremise de votre bienveillant ami et serviteur Monsieur le gardien de la prison, je pus apporter à un Julien détruit de désespoir, d’angoisse et d’amour frustré un pistolet caché dans un panier de nourriture que quelques pièces me permirent de faire passer sans fouille. Mon plan était simple : le lendemain, lors de sa promenade journalière, il menacerait le garde et quitterait la prison par un complexe chemin menant à une petite porte dont j’avais pris soin de relever la position. Il devrait alors courir au travers de la forêt jusqu’à un ancien manoir délaissé mais dont le souterrain menait aux égouts de la ville, et ainsi échapper aux chiens lâchés à sa suite. Le souterrain conduisait tout droit sous le palais du Conseil, où je l’attendrais avec une diligence prête à l’emmener dans la maison de son père. J’avais pris soin de sélectionner le personnel le plus dévoué et le moins bavard.
L’évasion impromptue du prisonnier Julien d’Aremor fut le second évènement à ébranler la ville et à mettre sous presse plus de journaux qu’il n’en avait jamais eu en un an, le premier étant l’assassinat du vieux gouverneur, prétendument par Julien lui-même.
Sans doute Julien a-t-il couru à se déchirer les poumons, les aboiements des chiens aux chevilles. Sans doute s’est-il engouffré par le souterrain, sans doute a-t-il trouvé la grille en question, derrière laquelle je devais l’attendre. Sans doute, car il tenait dans sa main crispée, lorsqu’on le retrouva criblé de balles, le médaillon en or du gouverneur, mort quelques semaines plus tôt, à l’endroit exact que je lui avais indiqué, de l’autre côté de la grille.
♣
Non, Monsieur. Il n’y a qu’à vous que je dirai cette vérité, à vous, le grand Maître du Secret et dont le serment force à être le dépositaire des plus ignobles histoires de la ville sans jamais pouvoir les révéler, puisque vous avez accepté officiellement d’être le dépositaire silencieux des tracas de toute la haute société dont je fais, grâce à la fortune et au rang de Julien, maintenant partie. J’ai fait des recherches sur votre étrange métier. Saviez-vous qu’il est né du besoin du premier gouverneur à avoir quelqu’un à qui avouer les horreurs que lui et ses conseillés commettaient au nom de la nation pour débusquer les anciens de la révolution? Saviez-vous que votre place dans la gouvernance s’est ensuite, et seulement ensuite, parée des plus beaux atouts? Mais le prix à payer est élevé, n’est-ce pas? Élevé, car votre protocole vous force à détruire toutes les lettres de vos clients – dont je fais partie depuis ce jour où je vous ai vu pour la première fois.
Voici la vérité, cette vérité trop lourde dont je ne veux plus et que je vous lègue dans sa totalité.
Qu’avait donc fait Julien ? Rien. Telle fut ma conclusion. Rien, et en même temps tout. Julien était coupable d’être l’un des membres du Conseil, coupable d’être un riche enrichi sur le dos des pauvres, coupable de vivre dans une maison immense, coupable d’avoir hérité de son père, coupable de m’avoir trouvée, moi, petite créature, et de n’avoir sauvé que ma personne de la crasse du bas-monde.
Julien devait mourir. C’était son prix, en échange des plaisirs sans fin que je lui avais fait connaître durant des semaines, ces plaisirs qu’il désirait plus que tout, sous sa timidité.
J’ai pris sa clef. J’ai tué moi-même par surprise le gouverneur, dans l’espoir de lui voler son pendentif, en tant que trophée, pour toutes les injustices qui peuplent ce monde. Si je ne l’avais pas laissé tomber par la grille de l’égout, sans doute aurais-je repris la clef de sur la porte, et plongé la ville dans un cahot politique où les six conseillés restants se seraient dénoncés les uns les autres pour mon plus grand plaisir. Mais j’ai préféré jouer une autre carte, passer à un plan plus machiavélique encore, Monsieur.
J’ai laissé la clef sur la grande porte du palais, et Julien a été arrêté. Je l’ai aidé à se libéré, lui donnant rendez-vous au lieu exact où le gouverneur était mort, et où je ne l’attendrais jamais. Je lui ai menti : il est tellement facile de suivre quelqu’un à l’ouïe dans le dédale de tunnels qui forme les dessous de la cité, que même un policier ivre l’aurait retrouvé.
S’il est mort, criblé de balles par les gardiens de la prison, c’est parce qu’il m’attendait sous la grille, sans doute blessé. Il avait retrouvé ce pendentif que je convoitais tant. Je l’ai, grâce à lui et à son sacrifice, récupéré.
Aussi, Monsieur, je vous remercie de m’avoir prise sous votre aile lors de notre première rencontre, dans ce restaurant chic qui me révulsait de luxe. Je vous remercie car sans vous je serais sans doute retournée au marché, chassée par les membres de la famille de Julien voulant récupérer ses biens. Je vous remercie car sans votre aide, je n’aurais pas réussi à lui rendre visite lorsqu’il était en prison, et que je n’aurais alors pas pu, au nom de cette fin tragique, obtenir du sentiment de culpabilité du Conseil vis-à-vis de son évasion, les pleins droits sur la fortune de feux messieurs d’Aremor.
Si je vous écris cette lettre, Monsieur, c’est parce que je sens en moi quelque chose grandir. Je porte la descendance de Julien et je voulais me débarrasser de la crasse que cette société de manières et de superficialité a laissée sur mes mains, pour que mon enfant vive sans l’éternelle purulente bienséance des hautes sphères.
J’entends bien faire de lui et par le droit de sang qui le lie au Conseil, un héros comme seule l’histoire en comporte. Et lui alors mettra au nom de la justice et de l’équité fin à cet univers manichéen où riches et pauvres vivent dans deux mondes parallèles assujettis l’un à l’autre.
Veuillez, Monsieur, agréer mes salutations les plus distinguées,
Votre reconnaissante,
Louise Bonnaguia d’Aremor.
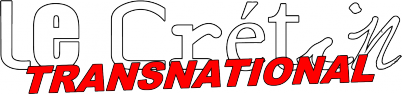



Comments by Mathieu Maender